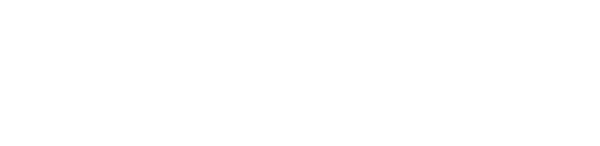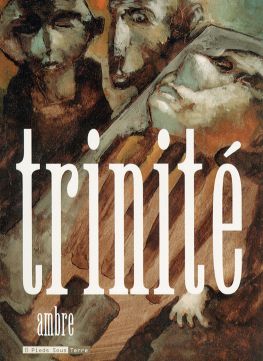Un travail solitaire
Ce qui suit est la transcription du début d’une discussion menée publiquement au Festival "Nouvelles images, Nouveaux talents" de Bourg-les-valence le dimanche 3 mars 2002. Suite au désistement d’un journaliste, on m’a proposé à la dernière minute d’interviewer Ambre. L’idée d’interviewer Ambre, avec qui je travaille, était assez angoissante. J’avais peur soit de tomber dans la complaisance, soit de faire quelque chose d’assez artificiel. L’interview, qui s’est déroulée devant une vingtaine de personnes, a vite bifurqué vers une discussion sur nos pratiques de travail, discussion à laquelle s’est jointe Valérie Berge. Voici la transcription des 45 premières minutes de cette discussion qui a duré une heure et demie.

Lionel Tran : Tu as commencé avec la revue Hard Luck, d’où est né le désir de créer une revue ?
Ambre : Hum. Il y avait plein de choses qui bouillonnaient au début des années 1990. Il y avait Paquito Bolino et Caroline Sury, qui m’impressionnaient beaucoup, ils travaillaient dans une revue de Bordeaux intitulée Hello Happy Taxpayer. Moi j’avais envie de faire un truc personnel, très expérimental. À l’époque on travaillait dans un atelier tous les deux à Lyon, avec des gens qui faisaient de la peinture et de la musique. J’ai même failli sortir un numéro avec un groupe lyonnais qui s’appelait Deity Guns [1]. Je voulais faire des rencontres, mais ça ne s’est pas passé comme ça, c’est resté quelque chose de très personnel. J’ai réalisé la plupart des numéros tout seul, d’une manière très artisanale et très bordélique. Très austère, aussi. Économiquement c’est moi qui mettais des sous, donc ensuite j’avais des rentrées, je faisais des petits salons de bande dessinée. C’était un travail très solitaire.
Lionel Tran : Tu avais quels moyens ?
Ambre : Financiers ? Qu’est-ce que je faisais à l’époque ? Je me rappelle que je faisais des boulots d’été dans un stade : je tondais la pelouse, il y avait une piscine, donc je la lavais tous les matins, je lavais les chiottes de la piscine. (Rire.) C’est comme ça que j’ai pu notamment acheter ma première machine à écrire, pour taper les sommaires de Hard Luck. Après j’ai eu la possibilité, d’imprimer les sommaires sur des imprimantes laser aux Beaux Arts, des choses comme ça. C’était vraiment artisanal, je faisais vraiment avec ce que j’avais sous la main. Je calculais le coût par numéro et je le vendais pratiquement au niveau du coût. S’il me coûtait 12 francs, je le vendais 15 francs à tout casser, parce que je me disais qu’il fallait que je fasse un peu de bénéfice… C’était complètement aberrant, ça ne marchait pas…
C’était un fanzine, fait avec un esprit peut-être plus littéraire. Je ne connaissais pas de gens qui faisaient de la bande dessinée, à part les amis très proches, qui ne travaillaient pas dans des revues. Hard Luck devait avoir un intérêt, parce que j’ai été contacté par Amok et par Six Pieds Sous Terre, avant qu’ils deviennent une SARL. C’était des gens dont j’estimais le travail.
Lionel Tran : C’était le seul moyen de publier ton travail ?
Ambre : C’est compliqué. J’avais beaucoup de réserves à présenter mon travail aux autres. J’envoyais des exemplaires, c’était l’occasion de présenter mon travail sans attendre quelque chose, parce que c’était déjà imprimé, c’était déjà tout prêt. J’envoyais ça pour voir si des gens étaient intéressés et, éventuellement, me demandaient un projet. Je n’étais pas du style à aller voir les gens avec des planches, j’avais horreur de ça. J’ai un côté très réservé, un peu pudique.
Lionel Tran : Donc cette auto publication t’as permis de te faire connaître ?
Ambre : Il me semble, oui.
Lionel Tran : De trouver un public ?
Ambre: À l’époque, c’était très confidentiel. Très très très confidentiel.
Lionel Tran : Cela t’a permis en tout cas de trouver quelqu’un qui était prêt à éditer ton travail…
Ambre : Au moins quelqu’un qui me disait : c’est intéressant, nous on fait ça, voilà, est-ce que ça t’intéresse aussi de faire des choses ensemble. Pour moi c’était ça qui était important, de ne pas être tout seul à ma table, de créer des liens. Parce que j’avais des amis autour de moi qui faisaient de la peinture, mais j’étais assez seul à faire de la bande dessinée. Même toi, à l’époque, on essayait de faire des projets, mais tu n’étais pas totalement là-dedans. (Silence.) Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que tu cherchais ta voie de ton côté. Pour toi ce n’était pas facile de faire une revue. À l’époque tu faisais plutôt du journalisme. Donc je n’osais pas trop te demander des choses, je me demandais si ça t’intéressait ce que je faisais, franchement. Pour moi tu étais quelqu’un de plus sérieux en fait, de moins… (Rire.)
Lionel Tran : J’ai arrêté de dessiner quand j’ai découvert tes récits. Parce qu’il y avait une maîtrise de la narration chez toi, je me rappelle avoir vu tes bandes dessinées au lycée, et m’être dit immédiatement après : " - il faut que j’arrête ça." À l’époque tu éditais ton premier fanzine, qui s’appelait Anus.
Ambre : Anus, oui .(rires)
Lionel Tran : J’ai commencé à avoir envie de travailler sur des scénarios de bande dessinée, mais pour moi ça voulait dire faire un travail créatif personnel avant de pouvoir faire un échange avec quelqu’un et ça je ne m’en sentais pas capable. Pour moi le journalisme ce n’était pas de l’écriture et il fallait que j’entreprenne ce travail seul…
Ambre : C’est paradoxal parce que pour moi ça me semblait avoir plus de poids ce que tu faisais.
Lionel Tran : D’accord.
Ambre : (Rire.)
Lionel Tran : Et donc tu as rencontré Six Pieds Sous Terre, qui a été un des premier éditeurs à soutenir ton travail. Peux-tu parler de ton premier album chez eux, Chute…
Ambre : Il s’agit de récits qui avaient été publiés dans Hard Luck. Chute était le deuxième album de Six Pieds Sous Terre. Jean Philippe Garçon des éditions Six Pieds Sous Terre voulait absolument faire un album avec moi, alors peut-être que lui n’a pas osé me demander quelque chose de nouveau ou peut-être qu’il aimait ces récits. En tout cas il m’a dit : " - il y a deux récits de toi que j’aimerais publier ensemble", ce qui éditorialement est complètement aberrant -un album fait de deux récits moyennement courts. Ils m’ont proposé ça, moi j’étais ravi.
Lionel Tran : C’est un album qui est assez audacieux, qui a énormément de changements de point de vue, où ton dessin se modifie à chaque page, presque à chaque case, où le physique des personnages évolue en fonction de leur état d’esprit. Les techniques utilisées sont très variées, tu revois parfois la même situation sous plusieurs angles. C’est un récit qui a reçu quel accueil ?
Ambre : Je ne sais pas. Je crois que certaines personnes étaient plus impressionnées par l’atmosphère, il se dégageait un truc assez lourd, assez pesant, donc les gens soit rejetaient ça, soit étaient vraiment dedans. Et d’autres personnes, je pense surtout à des étudiants des Beaux Arts, étaient plus intéressés par l’aspect technique et esthétique.
Lionel Tran : À la période où tu as dessiné Chute, tu faisais beaucoup d’expériences plastiques, tu faisais de la peinture à l’huile, par exemple. Chute est d’ailleurs en partie peint.
Ambre : C’est difficile pour moi de parler de peinture parce que je n’en fais plus en ce moment, parce que je n’ai plus le temps. Et puis peut-être que ça me prend trop d’énergie pour faire autre chose à côté, faire de la bande dessinée. Bon, je suis de plus en plus lent, apparemment. Est-ce que c’est de l’exigence ? Je ne sais pas. J’ai envie de prendre plus le temps de faire les choses. Je fais des choix. Il y a plein d’activités que je faisais avant, je les élimine. C’est un peu sec de dire ça, mais je faisais de la musique aussi. Je me dis que je ne peux pas tout faire, qu’il y a des choix à faire et voilà. Donc, la peinture, c’est ça, j’ai un peu mis ça de côté, en me disant que je n’ai que trente ans et que dans 50 ans j’en ferai peut-être, je n’en sais rien.
Lionel Tran : J’aimerais que l’on revienne un peu sur Chute, dont l’approche est vraiment très mouvante, où l’on n’est pas justement dans ce qui définit traditionnellement une bande dessinée. Par exemple, les personnages n’auront pas la même tête d’un bout à l’autre du récit. C’est quelque chose que tu as développé par la suite dans la plupart de tes travaux…
Ambre : Oui, parce que je n’y arrive pas. C’est peut-être une bêtise de dire ça mais je crois que je n’arrive pas à faire une tête identique dans chaque case. Je crois que les partis pris on les prend comme ça, plus pour masquer des faiblesses, ou les choses que tu n’as pas envie de faire. Mais moi je me demande si je suis capable de faire ça, techniquement, c’en est à ce point là…
Lionel Tran : Une année sans printemps, le deuxième album que nous avons fait ensemble amène un changement de style radical. Cela faisait plusieurs années que tu faisais des récits peints et tu as réalisé ce récit avec un trait beaucoup plus spontané. Actuellement tu travailles sur un récit qui a une approche graphique très différente. Ça procède de quoi ? D’une volonté de changer ?
Ambre: Oui, mais cette volonté est amenée par plein de choses. Pour le style d’Une année sans printemps, qui est un peu lâché, toute l’année 2000 en fait j’ai animé des ateliers de dessin d’après modèle, donc j’étais un peu dans ce mouvement là, ça me nourrissait et voilà, ça rejaillit sur les planches que je faisais à ce moment là. Le récit s’y prêtait. Quand je commence un récit, à chaque fois je suis obligé de faire la première planche une dizaine de fois avant de trouver un truc où je me dis : avec ça je peux faire cinquante planches qui peuvent me tenir en haleine, qui peuvent me surprendre, parce que sinon… C’est très dur de faire cinquante pages en un an, c’est vraiment un travail bureaucratique, c’est très répétitif, tu as ton canevas, c’est toujours la même dimension, il faut que tu penses au départ du récit, à la fin, c’est tout planifié quand-même. Même si on travaille de manière empirique, il y a quand-même une trame qu’il faut garder. Il faut, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, il faut une longue haleine, une vision très large de ton travail. Donc si moi je ne sens pas la première planche, ce n’est pas la peine de continuer.
Lionel Tran : C’est une grosse prise de risque, parce que les gens avaient identifié ton style.
Ambre : Oui. Enfin, une grosse prise de risque… Ce n’est pas une question de vie ou de mort. Moi je pense plutôt à l’éditeur, je me dis : ohlala, moi je me lance là-dedans, ça va peut-être foirer, l’éditeur lui il va sortir des sous pour faire ça il va sortir de la promo. Et puis par rapport à toi aussi, par rapport à un scénario que tu as travaillé, parfois avec difficulté, comme un travail à part entière, et je me sens quand-même responsable de ça et des fois ça me fait un peu peur, quand je pars dans des styles différents, mais je ne peux pas faire autrement, sinon je ne le sens pas, donc j’arrête tout.
Lionel Tran : L’année dernière tu as sorti Trinité, qui est en fait le "remake" d’un album que tu avais sorti dans ta revue Hard Luck. Ce récit était dessiné au trait, tu l’as complètement repris. Pourquoi avoir choisi de redessiner un récit entièrement ?
Ambre : Je ne sais pas. Peut-être parce que le récit me plaisait, mais pas sous sa forme existante. Je crois que c’était aussi une période plus ou moins de crise, quand je dis ça ce n’est pas de façon dramatique, c’était parce que je pense que je ne savais pas trop où j’allais. Ça me permettait de passer un an à faire quelque chose dont j’avais déjà le scénario. En même temps c’était quelque chose de personnel. Je crois que j’étais un peu paumé aussi, mais gentiment, gentiment paumé.
Lionel Tran : Comment s’est passé ce travail ?
Ambre : J’ai repris exactement les mêmes planches, j’ai travaillé ce qui n’allait pas. Ça s’est passé très très bien.
Lionel Tran : C’était un exercice de style ?
Ambre: Non, c’était plus une discipline, pour moi. J’avais fait un tout petit format, c’était très simple, il n’y avait pas de crayonné, pratiquement, c’était très pictural. Je me faisais plaisir. Je crois que c’était surtout ça.
Lionel Tran : Et en même temps tu as transformé le récit à plusieurs endroits, tu as intégré des récits courts, qui étaient inaboutis, que tu avais passé notamment dans Cheval Sans Tête.
Ambre : C’était une manière de rassembler des choses qui étaient un peu dispersées. J’ai un petit côté "patrimonial", on va dire, je n’aime pas que les choses soient perdues à droite à gauche, j’aime bien faire un tout, faire quelque chose de cohérent. Comment dire ? Plus ça va moins je travaille "pour moi", pour des choses qui ne sont pas publiées. J’ai envie de travailler, la moindre chose que je fasse, dans un tout, dans un travail global, qui va être sous forme de livre au final.
Lionel Tran : Tu as toujours fait tes scénarios, tu as toujours eu une maîtrise de la narration. Pourquoi est-ce que tu as eu le désir de travailler avec quelqu’un d’autre, qui écrivait ?
Ambre : Parce que je ne suis pas d’accord avec ce que tu dis en fait. (Rires) Pour moi ça ne se tenait pas du tout. Il y avait une atmosphère, des choses comme ça, mais je crois qu’une grosse partie de ma gêne à présenter mon travail c’était ce côté narratif qu’il me semble que je ne contrôle pas. Quelque chose que je ne contrôle pas du tout, que je fais un peu empiriquement. Voilà. Travailler avec toi ça me permet de me reposer quand-même sur un canevas, quand-même plus structuré. Ça me facilite beaucoup de choses.
Lionel Tran : Le premier bouquin que nous avons fait ensemble ça a été un chantier de longue haleine qui était assez curieux. J’aimerais que l’on revienne sur comment ce travail-là s’est fait. J’avais le désir depuis longtemps de travailler avec toi, on avait essayé, ça ne s’était jamais fait. Tu m’as redemandé de travailler sur un album et moi je t’ai remis un journal intime que j’avais tenu pendant une certaine période et après je me suis barré pendant trois mois pour ne pas savoir ce que tu en penserais. Quand je suis revenu, tu avais fait les premières pages, que nous avons entièrement refait par la suite. Je t’avais remis ce journal en te demandant "si tu y trouvais matière" et toi tu avais pris certains éléments. Ces éléments donnaient une direction que j’ai essayé d’affiner petit à petit. Ça a été très long.
Comment, toi, tu as vécu le démarrage du Journal d’un loser ?
Ambre : Il y a plusieurs trucs. Bon, j’ai essayé de prendre ton journal vraiment comme un point de départ pour le projet. J’ai essayé de mettre tout ce qui était, comment dire, tout ce qui touchait à l’intime de côté, en me disant que tu m’avais confié ça dans un but de travail et en même temps pour moi c’était une marque de confiance. On ne fait pas lire son journal intime comme ça, facilement. C’est pour ça que je crois que j’ai tout de suite commencé à travailler, pour amorcer tout un tas de choses et arrêter de me dire que j’étais en train de lire ton journal intime. C’était une base de travail. C’était assez éprouvant à lire, c’était…
Lionel Tran : Gênant…
Ambre : C’était gênant et c’était écrit très petit, c’était une écriture manuscrite sur un cahier d’écolier et c’était vraiment minuscule, déjà physiquement c’était très dur. Il fallait une certaine concentration. Puis c’est vrai que c’était gênant. Je te connaissais et tu parlais de gens que je connaissais. Et tout de suite j’ai commencé les premières pages pour lancer la machine. Et puis aussi pour te montrer que pour moi c’était sérieux. Pour à ton retour te mettre les planches dans les mains. Une marque de considération, pour moi. Te signifier que c’était sérieux ce qu’on faisait

Lionel Tran : Ce projet, est devenu Le journal d’un loser. Très vite on a laissé de côté ce qu’il y avait dans le journal pour partir sur une sorte de reportage intimiste. On s’était dit, de manière un peu prétentieuse, qu’on voulait restituer le sentiment propre à notre génération, un sentiment de mal-être diffus. Et on avait fixé des "stéréotypes" de ce mal-être, qui étaient des situations ou des objets : le vernissage, la soirée vidéo, l’informatique et après on "partait en reportage", on allait voir nos amis et moi j’essayais d’enregistrer dans ma tête les sensations pour restituer ça. Je t’ai donné mon journal la veille de mon départ pour un voyage dans un pays étranger et je suis en train de réaliser que cela faisait plusieurs mois que j’avais commencé à tenir un journal assez fragmentaire. Et pendant les trois mois de ce voyage, il y a eu un déclic dans mon écriture. J’ai tenu un journal très très dense, où j’écrivais cinq heures par jour. Je n’ai jamais écrit autant. J’étais dans un contexte complètement étranger où je n’avais plus de repères et je transcrivais tout, toutes les conversations, la plupart des gestes. Et c’est vrai que quand je suis revenu, dans le travail que nous avons entrepris en commun, j’étais chargé de ça. Et je réalise que cela a beaucoup joué sur Le journal d’un loser. En revenant, je me suis dit : je ne souhaite pas voyager tout de suite à nouveau mais je souhaite avoir sur mon univers quotidien le recul que j’ai trouvé là-bas en étant dans un contexte étranger. C’est resté un objectif qui est, je crois, continu dans les recherches que nous pouvons faire ensemble. Ce travail a été particulier aussi, et ça il m’a fallu longtemps pour m’en rendre compte, parce qu’on s’est servi d’un troisième regard, qui était le regard de Valérie Berge. Valérie prenait des photos de notre entourage depuis plusieurs années, depuis bien avant que moi je fasse des tentatives autobiographiques et que toi tu t’aventures sur un terrain plus réaliste. Donc on a travaillé à partir de ses images, que nous lui avions emprunté, et progressivement elle a participé à l’élaboration de l’album. Je crois que les portraits que tu faisais, Valérie, a déterminé l’approche de l’album. Est-ce que tu peux parler de ce travail de photos que tu faisais sur notre entourage ?
Valérie Berge : Les premiers portraits que j’ai faits, étaient ceux d’une personne qui avait une vie tellement dissolue, qu’on pouvait penser qu’il allait mourir très vite. C’était quelqu’un dont on était très proches, qu’on aimait bien, alors voilà c’était pour garder une trace. Et comme il n’est pas mort, je l’ai pris en photo très régulièrement. C’est comme ça que j’ai commencé à faire un travail photographique sur le vieillissement, les traces physiques du temps qui passe. Ce que je continue aujourd’hui à faire avec les auteurs de bande dessinée qu’on voit sur les festivals (rire.) C’est quelque chose que je me suis mise à faire avec les gens que j’appréciais. C’était un travail de portrait en général.
Quand j’ai commencé à faire des portraits, j’étais assez timide et les gens que je prenais en photo étaient assez timides aussi, et disons que pour éviter les préliminaires j’étais assez brutale, je les collais devant un mur et je faisais très rapidement mes portraits, comme une sorte d’écriture spontanée, très directe. Ensuite j’ai appris à prendre les gens dans leur environnement, de manière plus naturelle. Et quand vous avez commencé à utiliser ces photos que j’avais fait des années avant, j’ai fait après des photos dont vous aviez besoin, sachant qu’il y allait avoir telle ou telle scène, comme la scène de vernissage ou la scène de la soirée d’anniversaire. C’est vrai que je pensais à tes dessins, mais je suis toujours partie dans l’optique que c’était des photos que je faisais pour moi. De toute façon tu ne les as pas toutes utilisées, il y a aussi des photos que j’aime bien que tu n’as pas utilisées.
Ambre : C’est quelque chose qui m’est resté, ça, travailler d’après photos. Je pense que ça a été la première fois que je m’en servais comme ça. J’ai l’impression que je m’en sers de plus en plus. Alors pour le prochain projet qu’on va faire, c’est flagrant, pour chaque case il y a une photo à la base. Et c’est de pire en pire… Toutes les dernières expositions que j’ai vues, c’était des expositions de photographies, c’est ce qui m’intéresse en ce moment. Alors voilà, tu déteins sur moi. C’est vraiment ce qui m’intéresse.
Valérie Berge : Je sais que toi aussi tu t’es mis à faire des photos et, à la limite, pourquoi tu ne fais pas tes photos ?
Ambre : Parce qu’elles sont moins bonnes que les tiennes.
Valérie Berge : Je ne suis pas d’accord avec toi.
Ambre : (Rires.) Si, si, c’est ça. Sur une pellicule, il va à la limite y en avoir une où je peux prendre un détail, c’est inutilisable. Justement, travailler avec toi, c’est qu’il y a une qualité, avec des nuances de gris, des choses comme ça… Et puis il y a un regard surtout. Moi, je n’ai pas un regard de photographe. Mes photos c’est des photos de touriste.
Lionel Tran : Il s’est mis en place une relation de travail croisé assez étrange.
Pour ma part, je sais que j’ai commencé à chercher dans mon écriture quelque chose qui ne soit pas faux - je ne me disais pas quelque chose de juste. Or pour faire quelque chose qui ne soit pas faux, il fallait chercher dans une expérience. Le second album, Une année sans printemps, c’est trois fragments de vie d’artistes. Et l’idée c’était, non pas de rendre hommage, mais de rendre justice à ces créateurs, dont l’œuvre avait été importante. Donc l’idée ça a été de se mettre dans leur peau. De ne pas faire d’eux ce qu’ils n’étaient pas mais de retrouver derrière leur œuvre ce qu’ils avaient pu être. J’ai beaucoup lu de biographies de ces gens-là, jusqu’au moment où je sentais une résonance, un point commun avec ce que je pouvais vivre. Ça a été un projet beaucoup plus simple, qui a été beaucoup plus vite. Et le projet sur lequel nous travaillons actuellement, depuis plusieurs années, c’est l’adaptation d’un roman l’écrivain tchèque Bohumil Hrabal. C’est un roman qui s’appelle Une trop bruyante solitude, qui se passe dans les sous-couches du métier de l’imprimerie et du livre. C’est l’histoire de quelqu’un qui est tout en bas de la chaîne, qui détruit du papier. Et pour aborder ce bouquin, c’était la troisième expérience en commun, mais je n’ai pas réfléchi à ça, j’ai senti d’instinct, qu’il fallait m’immerger dans ce milieu là, pour pouvoir en parler. Sinon, je n’aurais pas été capable d’être juste. Je cherchais du travail à cette époque-là, alors je suis allé travailler dans une imprimerie. Au bout d’un an passé à travailler comme massicotier je t’ai invitée à venir prendre des photographies à l’imprimerie.
Valérie Berge : Tu m’avais tellement parlé des ouvriers qui travaillaient là-bas en leur donnant des surnoms comme "l’imprimeur", "le collectionneur", que c’étaient devenus pour moi des sortes de personnages.
Lionel Tran : Dès ma première journée de travail j’ai fait une sorte de casting. L’ouvrier que nous avons choisi pour Hanta, le personnage principal, s’est imposé assez vite. C’était le personnage, il vivait la même réalité. Je n’ai jamais envisagé par exemple de faire jouer le rôle à quelqu’un.
Valérie Berge : Quand je suis arrivée là-bas, ça s’est passé assez facilement. J’ai fait beaucoup de portraits et j’ai également commencé à prendre des machines. Le script n’était pas encore écrit. Ce qui est étonnant, c’est que lorsque nous sommes retournés montrer les premières planches à l’imprimerie, un an plus tard, nous avons appris que cet ouvrier avait lui aussi travaillé sur une presse à papier, ce que nous ne savions pas.
Lionel Tran : En voyant le dessin de la presse, il s’est exclamé : " - Ça, c’est une compacteuse. Je sais, j’ai travaillé dessus." Et nous on s’est regardés, la coïncidence était trop belle.